Dans de nombreuses entreprises, la « logique du meilleur d’entre nous » prévaut encore : on promeut par défaut le meilleur élément d’une équipe au poste de manager[1]. Or, ce n’est pas parce qu’un collaborateur excelle en tant que contributeur individuel qu’il a envie de manager ; ni qu’il en a les compétences.
Historiquement, on supposait à tort que l’expertise technique garantissait des aptitudes managériales. Cette idée reçue mène à des promotions hasardeuses, d’autant que les jeunes générations se montrent de moins en moins attirées par le rôle traditionnel du chef d’équipe. En effet, selon une étude de 2024, plus de la moitié des moins de 30 ans ne souhaitent pas assumer de responsabilités managériales.
Dès lors, faut-il vraiment promouvoir systématiquement le meilleur collaborateur comme manager ? Comment éviter que la promotion d’un talent technique ne se transforme en piège pour lui et pour l’entreprise ?
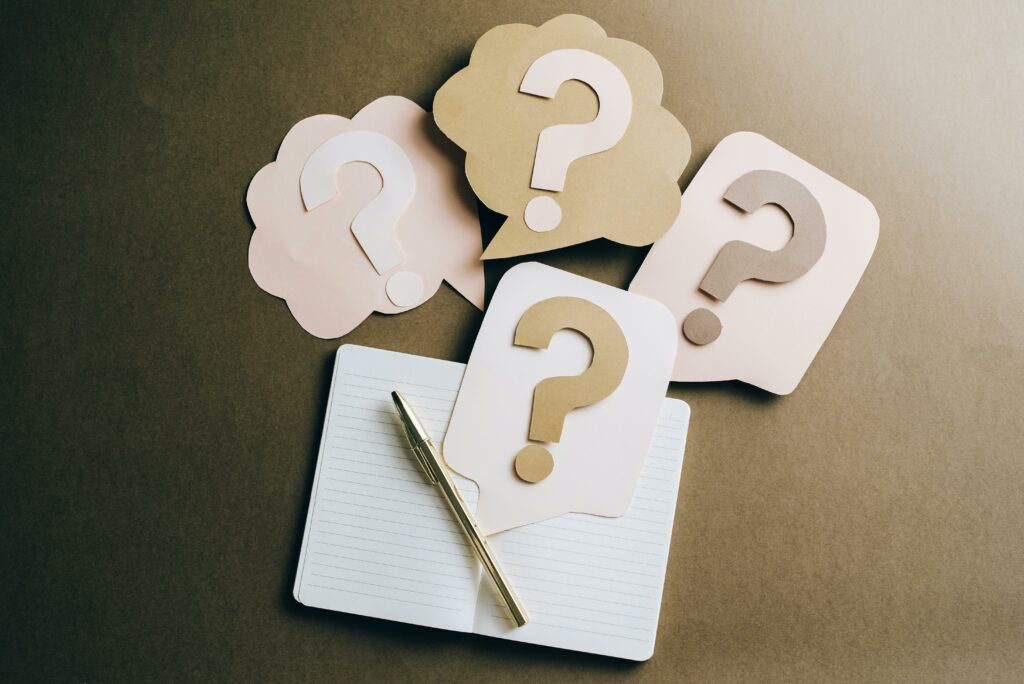
Excellence individuelle ≠ compétences managériales
Le réflexe consistant à promouvoir le meilleur élément de l’équipe au rang de manager est une pratique répandue mais contestable. Une étude de grande ampleur a confirmé que les meilleurs employés promus ne sont pas forcément les meilleurs managers[2]. En d’autres termes, exceller dans son métier ne garantit pas de savoir encadrer une équipe. Manager requiert en effet des compétences bien différentes de l’expertise métier : leadership, communication, organisation, empathie, capacité à faire grandir les autres, etc. Mal préparé, un expert technique propulsé manager devient souvent un « manager accidentel » placé à un poste qu’il n’a pas forcément désiré, sans y avoir été formé[1]. Comme le résume ironiquement le principe de Peter, tout employé tend à être promu jusqu’à atteindre son niveau d’incompétence[3]. Sans accompagnement adéquat, ce nouveau manager risque de se retrouver dépassé par des missions pour lesquelles ses succès passés ne l’ont pas suffisamment outillé.
Cette situation s’explique aussi par un défaut de préparation. Trop souvent, la promotion se fait « sans filet », sans formation ni phase de transition. L’entreprise mise sur les qualités intrinsèques du collaborateur en espérant que « ça passera ». Or, ça ne passe pas toujours. Parmi les exemples courants, un excellent commercial pourra être nommé directeur commercial du jour au lendemain sans aucune initiation au management d’équipe, à la gestion budgétaire ou à la conduite de réunions. Du jour au lendemain, on attend de lui qu’il abandonne une partie du faire pour maîtriser l’art du faire-faire. Livré à lui-même, ce manager débutant risque de commettre des erreurs coûteuses, de s’épuiser et de perdre confiance, faute d’avoir développé les savoir-faire et savoir-être nécessaires.
Jeunes talents : l’ambition de manager en question
Contrairement aux idées reçues, la jeunesse n’est pas forcément réfractaire à toute fonction managériale. Certes, une enquête Robert Walters indique que 52 % de la génération Z ne veulent pas être managers, beaucoup percevant ce poste davantage comme une source de contraintes et de stress que comme une récompense valorisante. La pandémie a renforcé cette quête d’équilibre : la carrière demeure importante, mais pas au prix d’un mal-être. On parle ainsi de « conscious unbossing », le fait de refuser sciemment un poste de manager pour privilégier d’autres formes de réussite professionnelle[4].
Pour autant, tous les jeunes ne fuient pas les responsabilités d’encadrement. Une étude récente nuance ce tableau en montrant que 58 % des 20-30 ans aspirent au contraire à manager un jour[10]. La différence ? Ces aspirants-managers souhaitent redéfinir le rôle. Ils se projettent dans un management plus horizontal, centré sur le coaching, l’écoute et la co-construction, loin du modèle rigide d’antan. En fait, les nouvelles générations veulent donner du sens à la fonction managériale : être manager, oui, mais pour animer une équipe et avoir un impact positif, pas pour contrôler ou recevoir un titre prestigieux. Face à ces attentes, le défi des entreprises est double : ne pas forcer des talents qui n’en ont pas envie à devenir managers mais surtout accompagner ceux qui le souhaitent à exercer ce rôle autrement. Et cela commence par prendre conscience de ces mouvances nécessaires.
Les risques d’une promotion mal avisée
Promouvoir une personne qui n’est ni prête ni faite pour être manager comporte de réels dangers, tant pour l’individu que pour l’organisation[5] :
- Performance en berne : un collaborateur brillant peut, une fois manager, obtenir de moins bons résultats s’il n’arrive pas à mobiliser son équipe ou à déléguer. Il doit faire face au fait que son succès ne dépend plus que de lui mais de toute son équipe. On constate ainsi que les meilleurs contributeurs individuels ne deviennent pas automatiquement des managers performants[2].
- Démotivation du promu : propulser quelqu’un dans un rôle qu’il n’a pas souhaité ou sur lequel il n’a pas été bien accompagné peut entamer sa motivation. Le nouveau manager, submergé par des tâches pour lesquelles il n’est pas formé, risque de perdre confiance et plaisir au travail[1].
- Départs et désengagement : un management maladroit a un impact direct sur l’équipe. De nombreux salariés quittent leur poste à cause d’une mauvaise relation avec leur supérieur hiérarchique. Un « mauvais » manager peut précipiter le départ de certains de ses collaborateurs, ou miner leur engagement au quotidien[5].
- Coût pour l’entreprise : recruter ou remplacer un manager défaillant ou un collaborateur désabusé génère des coûts cachés (turnover, baisse de productivité, climat social dégradé). Au-delà, cela peut décourager d’autres talents internes de prendre des responsabilités, par crainte d’échouer à leur tour.
En somme, promouvoir le meilleur élément sans évaluation approfondie peut créer un cercle vicieux. L’entreprise perd un expert technique et gagne un manager démotivé, voire, dans certains cas, incompétent. Une situation qui est loin du win-win pour toutes les parties prenantes.
Valoriser autrement les talents : vers des parcours sur-mesure
Comment dès lors reconnaître et récompenser un excellent élément sans le pousser absolument vers un poste managérial ? La première piste est de repenser les parcours de carrière. Longtemps, la promotion au rôle de manager a été considérée comme la voie royale de l’évolution professionnelle. Il est temps de mettre fin à ce modèle unique. « L’entreprise doit réinventer ses parcours de carrière afin de permettre des évolutions qui ne passent pas nécessairement par une promotion au poste de manager », plaide un expert en management[6]. Certaines personnes sont épanouies dans le management, mais d’autres préféreront progresser via l’expertise technique, le mentorat ou des projets transverses[6]. Autrement dit, on peut évoluer en compétences et en responsabilité sans prendre la tête d’une équipe. De plus en plus d’organisations l’ont compris et offrent des cheminements parallèles : par exemple, des grades d’expert senior ou de référent qui permettent à un talent de gagner en statut et en rémunération sans gestion d’équipe directe.
Cette diversification des carrières répond aussi aux aspirations actuelles. Aujourd’hui, on observe chez les salariés une appétence pour des trajectoires moins pyramidales, centrées sur l’autonomie et la collaboration, plutôt qu’une obsession à devenir manager à tout prix. Valoriser un collaborateur peut donc passer par d’autres moyens : élargissement de son périmètre, montée en compétence, reconnaissance publique de ses contributions, missions de leadership informel (animation de projets, rôle de mentor interne, etc.), sans que cela implique forcément d’obtenir un titre de “manager”.
Mieux accompagner les primo-managers… et les autres
Bien sûr, si un collaborateur a l’ambition et le potentiel pour devenir manager, il faut l’y aider dans de bonnes conditions. L’erreur serait de le promouvoir sans préparation et le « laisser se débrouiller ». Au contraire, il est préférable d’y aller étape par étape : commencer par lui confier la coordination d’un projet ou d’un stagiaire, puis graduellement élargir son équipe et ses responsabilités. Durant cette transition, un suivi régulier fait foi. Le futur manager devrait bénéficier de formations ciblées (par exemple aux fondamentaux du leadership, à la communication managériale, à la gestion du temps) et de mentorat par un manager expérimenté. Des programmes d’onboarding et de coaching dédiés aux primo-managers – comme The Leadership Canteen ou l’AFEST (formation en situation de travail) – permettent de développer progressivement les compétences nécessaires tout en évitant de brusquer le nouveau promu.
Parallèlement, pour les collaborateurs qui n’ont pas d’appétence pour le management, l’entreprise a tout intérêt à le reconnaître et à proposer des voies d’évolution alternatives. Managers et RH doivent être à l’écoute des aspirations de chacun. Par exemple, organiser des points réguliers pour discuter des envies d’évolution de chaque membre de l’équipe aidera à identifier qui souhaite prendre des responsabilités managériales et qui préfère explorer d’autres pistes. Cette transparence évite de mettre la pression à ceux qui ne veulent pas « prendre du galon » et ouvre la porte à des carrières sur-mesure, où l’expertise et la contribution individuelle sont tout autant valorisées que le fait de gérer une équipe.
Le coaching individuel
Un coaching individuel peut aussi aider un collaborateur à clarifier ses motivations et à travailler sa posture avant de prendre des responsabilités managériales.
En conclusion : changer de paradigme managérial
Promouvoir systématiquement le meilleur élément au poste de manager est une habitude héritée du passé, qu’il convient de questionner à l’aune des réalités actuelles. La performance individuelle ne se transforme pas magiquement en compétence managériale – et certains talents risquent même de s’éteindre si on les place dans un rôle qui ne leur convient pas. À l’heure où beaucoup de jeunes professionnels recherchent du sens, de l’équilibre et de nouvelles façons d’évoluer, les entreprises ont tout intérêt à diversifier leurs modèles de progression. En proposant des alternatives à la promotion hiérarchique et en soutenant réellement les nouveaux managers dans leur prise de poste, elles gagneront sur tous les tableaux : des collaborateurs plus engagés, des managers plus compétents et épanouis, et au final une performance collective grandissante. Le véritable enjeu est de sortir du réflexe du « meilleur » promu par automatisme, pour passer à un management choisi et préparé – gage d’un leadership durable et porteur de sens.
